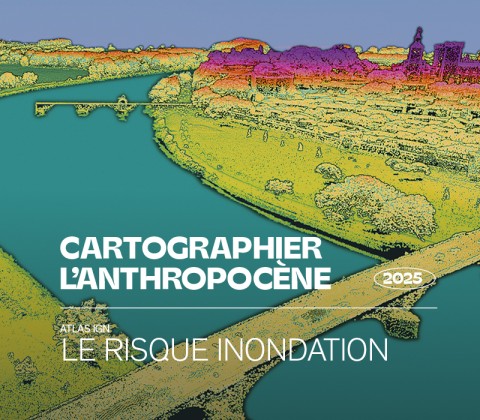Sur le terrain
Inondations : la culture du risque se construit collectivement
Publié le 08 septembre 2025
Temps de lecture : 15 minutes


Se préparer à la crue centennale
En raison de sa topographie et de sa localisation géographique, la France hexagonale a toujours été exposée au risque inondation. Bien que certains événements catastrophiques, comme la crue centennale 1 de la Seine de janvier 1910, aient davantage marqué les esprits, tous les grands fleuves français (Garonne, Rhône, Loire, Rhin) ont connu des inondations de même ampleur entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle. Dans le cas de la Loire, les plus hautes eaux connues ont été enregistrées en juin 1856.
Avec 7,58 mètres mesurés au niveau de la ville de Tours, le fleuve avait alors atteint près de dix fois sa cote habituelle pour cette période de l’année. « Si une montée des eaux similaire se produisait aujourd’hui, elle engendrerait entre 10 et 30 milliards d’euros de dégâts, assure Emma Haziza, docteure de l’École des mines de Paris et experte reconnue en adaptation climatique. Sur l’ensemble du Val de Loire qui constitue désormais un important pôle d’attractivité économique européen, un million de personnes et près de 250000 emplois seraient potentiellement affectés. »
1/4 des Français sont exposés au risque inondation par débordement de cours d'eau ou submersion marine (source : Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche)
22 Md€ c'est le montant que les plans de prévention des risques d'inondation ont permis d'économiser en dommages assurés, de 1995 à 2018 (source : Caisse Centrale de Réassurance)
Plus de 70 % des communes françaises ont déjà été déclarées en état de catastrophe naturelle pour ruissellement et coulées de boue (source : Caisse Centrale de Réassurance)

Emma Haziza est titulaire d’un doctorat en hydrologie de l’École des mines de Paris et experte de la résilience des territoires face aux extrêmes climatiques. Tout au long de sa carrière, elle a eu l’opportunité de former de nombreux acteurs et décideurs politiques à la gestion du risque inondation.

Swann Lamarche est ingénieur formé à l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). Il est chargé de relations partenariales à l’IGN dans le domaine de la prévention des risques et du changement climatique. Avant de rejoindre l’Institut, il a notamment travaillé à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France.

Véronique Lehideux est ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. Elle a commencé sa carrière à l’IGN où elle a travaillé pendant près de vingt ans au sein de divers services et directions, avant d’exercer en service déconcentré sur le développement durable. Depuis 2021, Véronique Lehideux supervise le service des risques naturels à la Direction générale de la prévision des risques (DGPR).

Benoît Thomé est diplômé de l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE) et de l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC). Il intègre Météo-France en 2007 où il est amené à diriger le Centre de météorologie spatiale de Lannion avant de prendre la tête de la Direction interrégionale Centre-Est. Depuis 2023, il dirige la Direction des relations institutionnelles de cet établissement public.
Mis à jour 17/12/2025

 Inondation de La Réole (Gironde) en mars 1930
Inondation de La Réole (Gironde) en mars 1930 Des agents municipaux portent secours aux populations lors de la crue du Loing à Nemours en juin 2016
Des agents municipaux portent secours aux populations lors de la crue du Loing à Nemours en juin 2016